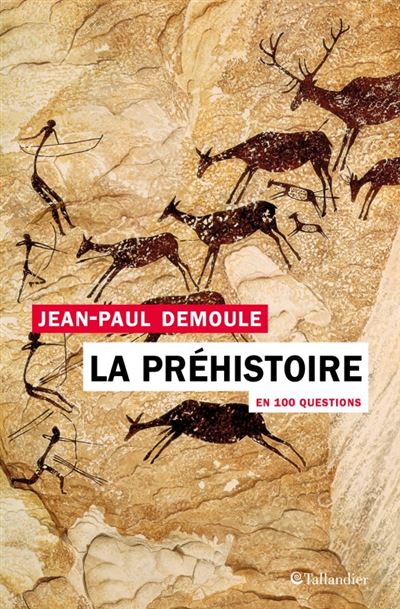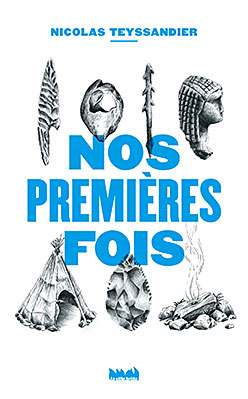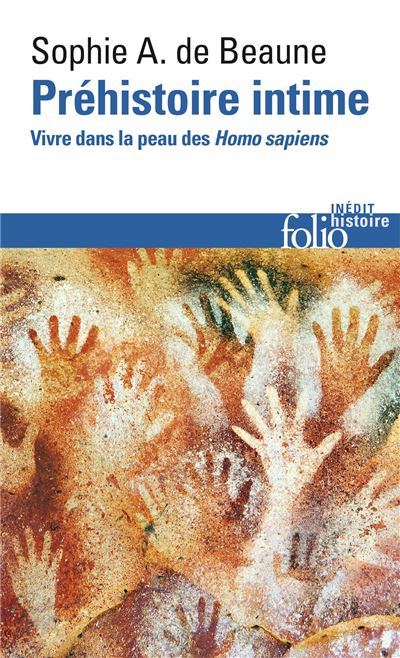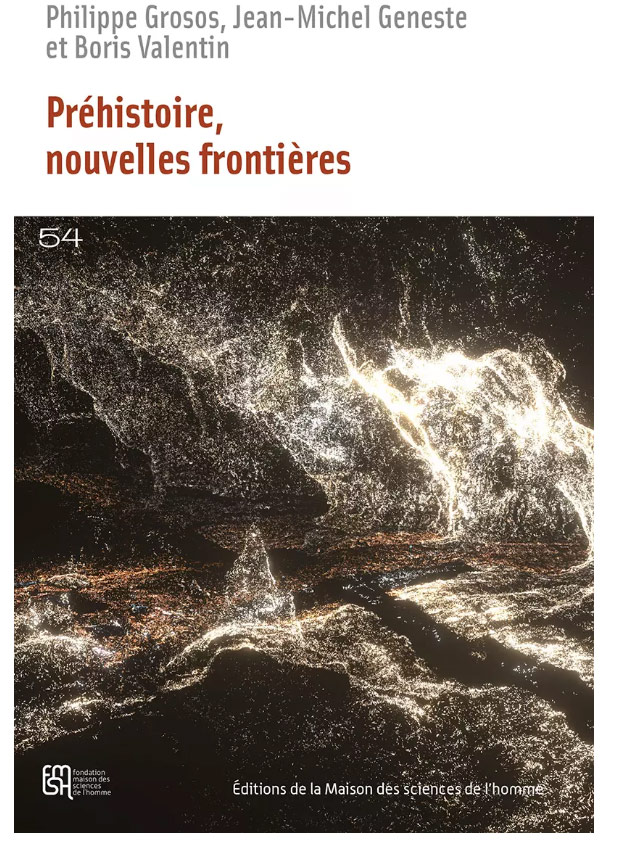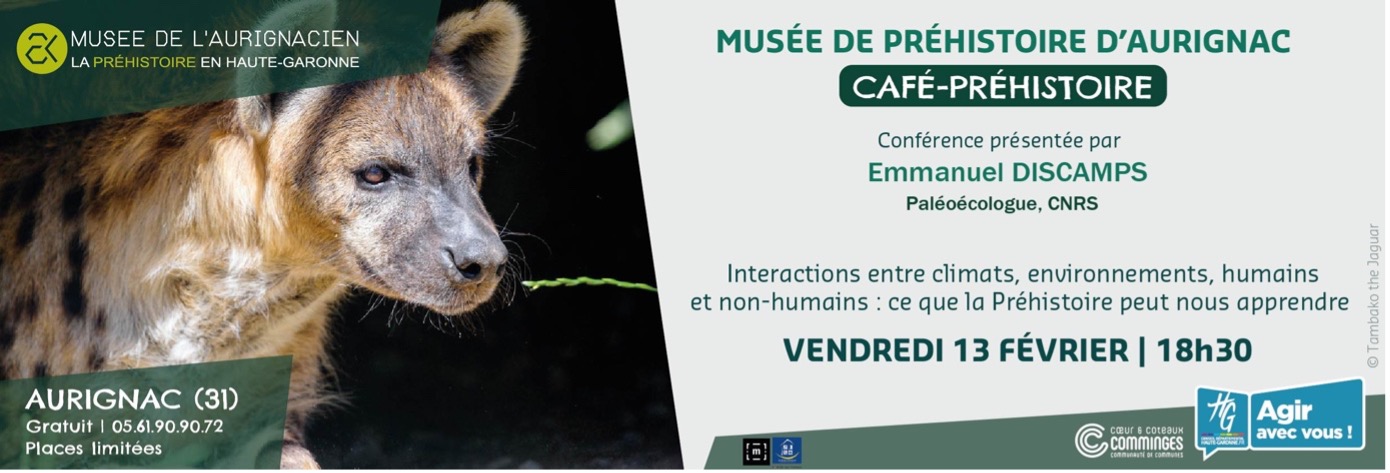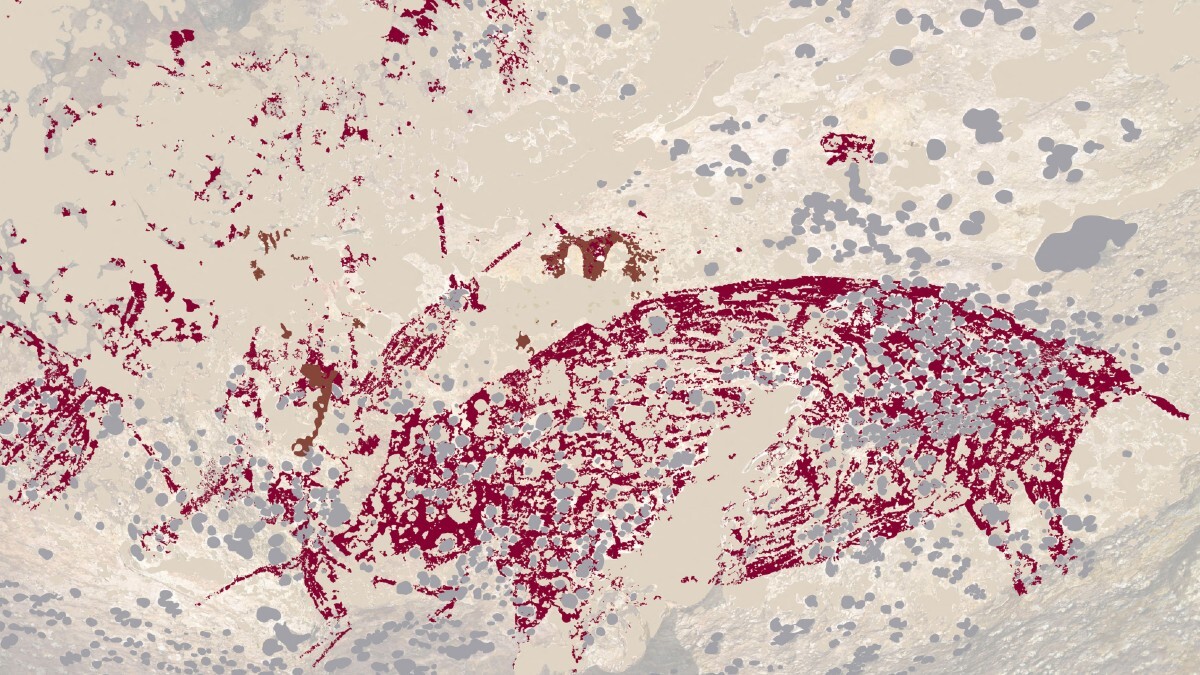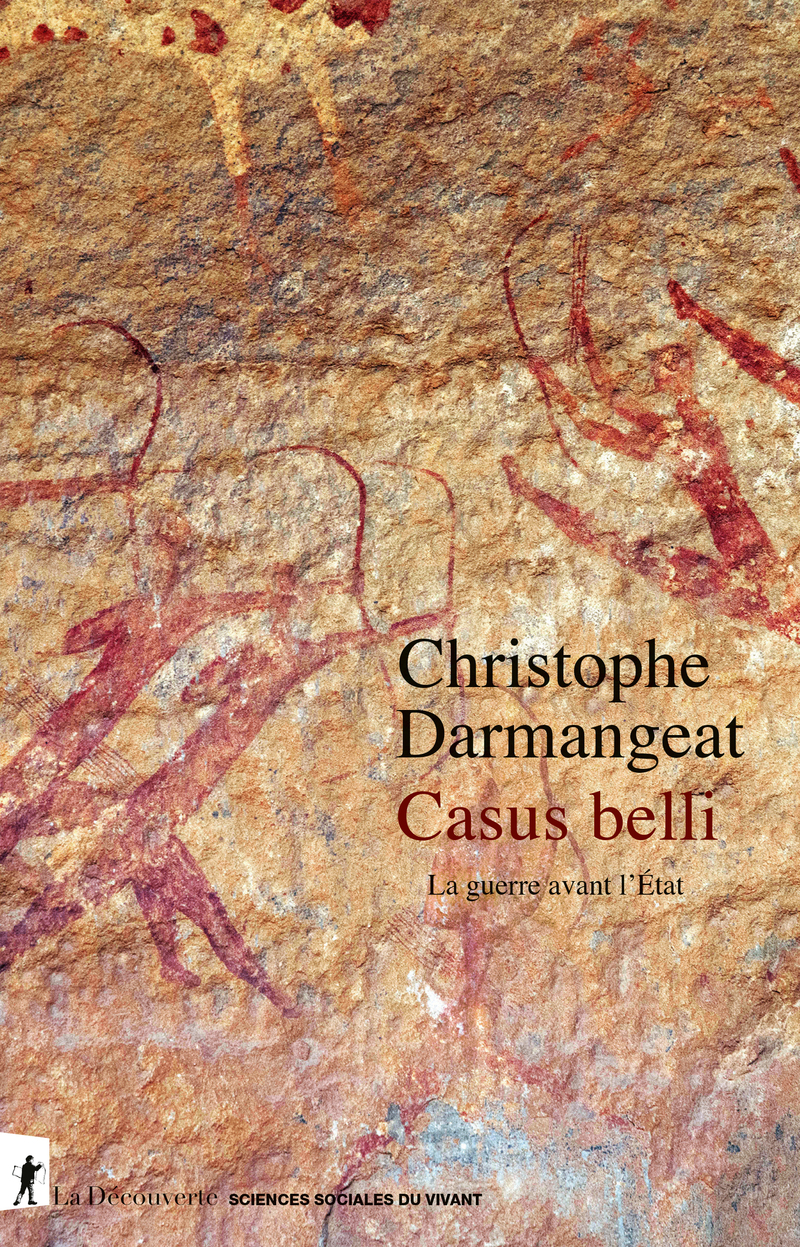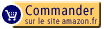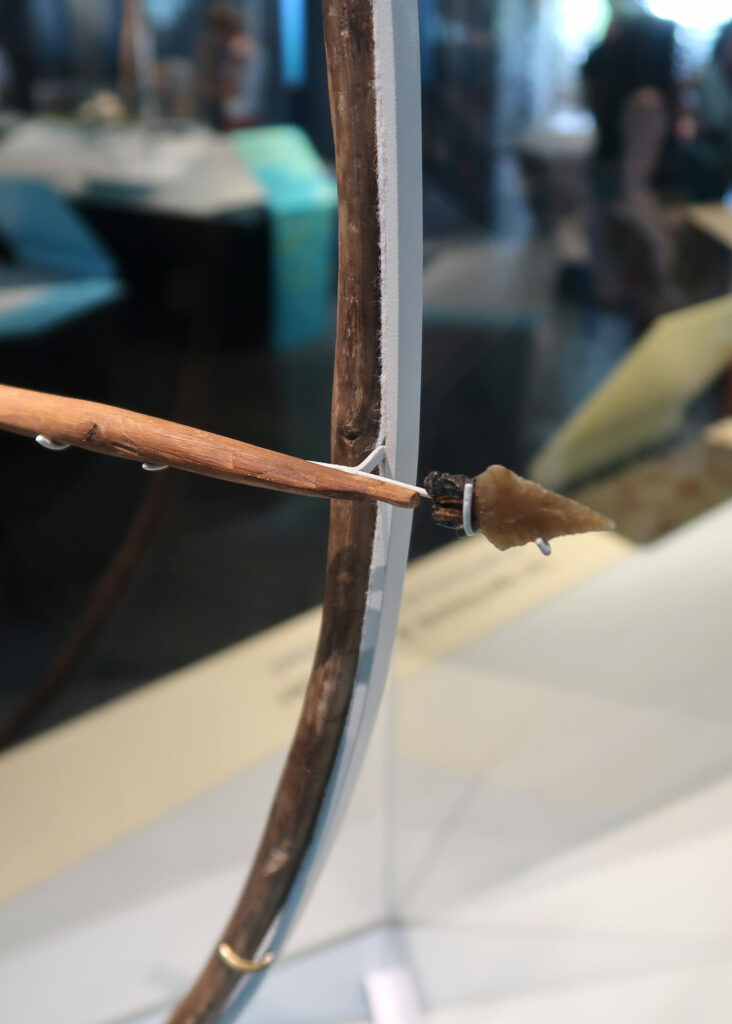Accueil / Livres et médias / Casus belli
Casus belli
Casus belli
La guerre avant l'État
Christophe Darmangeat
Compte rendu Romain Pigeaud
La découverte
Sciences sociales du vivant
Présentation par l’éditeur :
Il est souvent admis que la guerre authentique ne naît véritablement qu’à l’âge du Bronze – cette période étant supposée marquer l’apparition de combattants professionnels et d’un armement spécifiquement homicide. À rebours, un vaste courant de pensée plaide pour une origine bien plus ancienne. Ses tenants, qui inscrivent la question dans le temps long de l’évolution de l’humanité, relient nos dispositions belliqueuses aux observations effectuées sur les autres primates, en particulier les chimpanzés.
Au-delà de leurs divergences, ces approches s’accordent sur le fait que la guerre est intimement et nécessairement liée à l’appropriation de ressources. C’est cette idée, mais aussi l’assimilation de tout conflit collectif homicide à la guerre telle que nos sociétés étatiques la définissent que Christophe Darmangeat entend contester, sur la base de multiples données historiques et ethnographiques, dont celles portant sur des sociétés de chasse-cueillette mobile dénuées de toute inégalité de richesse. La plupart de ces affrontements sont menés pour d’autres motifs que l’appropriation de ressources territoriales, humaines ou matérielles, qu’il s’agisse entre autres de parvenir à un règlement judiciaire, de se venger ou d’acquérir des substances corporelles (têtes, dents ou scalps) réputées nécessaires à la vie.
Dans une large perspective comparatiste, ce livre ambitionne de recenser les diverses formes – presque toutes oblitérées par l’État – de ces confrontations collectives, d’en proposer une typologie raisonnée, de les mettre en relation avec les structures sociales et de traiter de leur (in)visibilité archéologique, afin d’éclairer leurs logiques profondes.
Christophe Darmangeat, 2025, Casus belli. La guerre avant l’État. Paris, éditions La Découverte, collection « Sciences sociales du vivant », 384 p
17,7 x 24,2 cm
.Compte rendu Romain Pigeaud
Quelle est l’origine de la guerre ? Nous fut-elle léguée par le Néolithique, comme la carie dentaire ? Ou bien provient-elle de notre part animale et sommes-nous condamnés à la voir réapparaître sans cesse ? Questions vertigineuses et pour certaines multiséculaires, que Christophe Darmangeat embrasse avec rigueur et méthode. Dans la lignée d’Alain Testart, il commence par rebattre les cartes et redéfinir les données du problème. Dans plusieurs chapitres lumineux, il démontre que « la guerre ne constitue qu’une forme particulière du vaste ensemble des confrontations collectives ». Contrairement à notre perception intuitive, les sociétés de chasseurs-cueilleurs sans État constitué ne sont pas particulièrement pacifiques et « possèdent des lois qui, si elles ne sont pas écrites, sont tout aussi élaborées que les nôtres et distinguent fort bien ce qui relève du pénal et du civil ». Le lecteur est mortifié d’apprendre toutes les façons que les humains ont inventées pour prendre la vie de son prochain : guerre, feud (se faire justice soi-même), chasse aux têtes, duels collectifs, « rituels de la paix », razzia… Christophe Darmangeat, après avoir établi des critères généraux qui permettent de dépasser les cas particuliers, propose une classification générale des confrontations collectives, qu’il expose et défend avec force exemples ethnographiques. La guerre est ainsi une confrontation collective discrétionnaire (sans accord préalable, « à la discrétion » de chaque camp) et résolutive (qui a pour objectif de « résoudre un différend et ee parvenir à des rapports plus apaisés »). Dans la deuxième partie, Christophe Darmangeat traite des origines de la guerre, à partir d’exemples pris dans le monde animal, dans les enquêtes ethnographiques et les découvertes archéologiques. Sans dogmatisme, il démontre qu’il existe un faisceau de présomptions qui plaident en faveur de la « chronologie longue »,, c’est-à-dire la profonde ancienneté des confrontations collectives, et même de la guerre (son existence chez les chimpanzés est toujours questionnée), sans qu’il soit possible d’en estimer la fréquence ou la proportion des sociétés qui en étaient affectées. Mais quels en seraient les motifs ? Dans une troisième partie, Christophe Darmangeat continue à questionner les remarques intuitives frappées au coin du « bon sens », qui se fissurent au contact de la réalité des données du terrain : accroître son territoire ? Conquérir des terres cultivables ? Augmenter ses ressources alimentaires (vol de récolte ou de bétail) ? Capturer des femmes ? Prendre la force vitale de l’ennemi ? Chaque exemple convoqué comporte des fragilités et suscite le débat. Attention cependant à ne pas verser dans un relativisme stérile : d’autres motifs existent, comme la vengeance, « l’homicide de compensation » ou le pur cannibalisme. Après un excursus contemporain sur la manière dont l’État canalise la violence au profit de la seule guerre inter-états, Christophe Darmangeat conclut de manière assez pessimiste : les hommes n’ont pas forcément besoin de raisons pour s’affronter : la xénophobie et le racisme sont universellement partagés ; « les groupes humains peuvent développer des relations d’inimitié du seul fait qu’ils existent de manière autonome et séparée ». Si l’État a « pacifié les rapports sociaux quotidiens », il a confisqué, selon lui, la violence au service d’une caste. Christophe Darmangeat forme des vœux pour une meilleure répartition des ressources et une plus grande interpénétration des circuits de production et de distribution, conditions sine qua non pour que la Paix règne enfin en ce monde.
Romain Pigeaud-Leygnac
Romain Pigeaud est un archéologue, préhistorien français spécialiste de l’art pariétal, et éditeur scientifique.
L’auteur Christophe Darmengeat
Christophe Darmangeat est anthropologue social, enseignant-chercheur à l’Université Paris Cité. Ses recherches portent sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l’évolution des rapports de genre, la formation des inégalités et des hiérarchies, le progrès technique ou encore l’organisation de la violence collective. Commissaire scientifique de la future exposition » Richesses et pouvoirs à la préhistoire » au Musée de l’Homme (2027-2028), il anime aussi un blog : la Hutte des Classes. Il est l’auteur de Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était. Aux origines de l’oppression des femmes (Smolny, 2022) qui paraitra en Poche à La Découverte le 2 octobre 2025, Justice et guerre en Australie aborigène (Smolny, 2021) et a codirigé avec Anne Augereau : Aux origines du genre (PUF, 2022).
Sommaire Casus belli
Remerciements
Prélude. Grandes gerboises et petites guerres
Une découverte australienne
Étranges étrangers
Sur le chantier de la guerre, toujours en travaux
Première partie
Une classification générale
1. Guerre et feud
Se faire justice soi-même
Un impératif social
Extensions idéelles
De l’homicide de compensation au feud
Des chaînes de vengeance
L’invention de la richesse : le » prix du sang «
Distinguer la guerre du feud
Classifier par les motifs ?
Les critères d’une classification générale
2. Confrontations conventionnaires résolutives
D’un commun accord
Duels libres et alternés
Les deux axes de la restriction de la violence
Les quatre types de résolution
Résolution par victoire
Résolution par catharsis
Résolution par équilibrage
Résolution par sanction de compensation
3. Confrontations discrétionnaires non résolutives
La définition des buts
L’acquisition
L’acquisition de biens (razzia)
L’acquisition d’êtres humains
L’acquisition d’éléments corporels humains (la chasse aux têtes)
Autres motifs
La vengeance
Le deuil
4. Confrontations conventionnaires non résolutives
Confrontations propitiatoires
Les pétales fanés de la guerre fleurie
Des confrontations sacrificielles avérées
Autres modes
Confrontations compétitives
Les » grands combats » des Enga
Combats identitaires (ou honorifiques)
Le sport
5. Remarques finales
Cas intermédiaires ou indéterminés
Entre résolution et non-résolution
Entre discrétion et convention
Les métamorphoses de la vengeance
De la bataille libre à la guerre
Seconde partie
Évolution des sociétés, évolution des modes de conflits
6. La quête des origines
Colombes et faucons
Le spectre de la nature humaine
Trois catégories d’indices
Distinguer la guerre des autres confrontations collectives
Éléments éthologiques
Des guerres inter-espèces ?
Conflits collectifs intraspécifiques
Spécificités humaines
Éléments ethnologiques
Du comparatisme
Des bases de données
Les chasseurs-cueilleurs mobiles
Éléments archéologiques et matériels
Les indices
Trois sites paléolithiques
Le conflit des interprétations est-il résolutif ?
7. L’enjeu des ressources
Une soif de territoires ?
Chasseurs-cueilleurs
Cultivateurs
Des apparences trompeuses ?
Un double paradoxe
Les biens meubles
Les femmes
Une lutte pour la vie ?
8. L’énigme de la prédation (ou : » Pourquoi se prendre la tête ? « )
Chasser le surnaturel
Prestige et reconnaissance sociale
Fondements mythiques
Une source de fertilité
Le nom des gens
Autres motivations
Aucune vie ne se perd, aucune vie ne se crée, tout se transfère, ou Lavoisier à l’âge de pierre
Une lecture matérialiste
Faire d’une tête deux coups : prédation et vengeance
La prédation sans la vengeance
Vengeance et prédation opportuniste
La prédation, fille de la vengeance
Deux cas limites
Une prédation purement idéelle ?
9. L’État contre la violence (des autres)
Réfréner et conscrire
La lutte étatique contre les confrontations conventionnaires
La lutte contre le droit de vengeance
La maîtrise de la violence extérieure
Conclusion
Une approche matérialiste alternative
Et l’avenir ?
Annexe. Guerre et feud , la théorie standard et sa critique
La théorie standard
Trois critiques
Un concept peu maniable
L’introuvable » communauté politique «
Une définition en trompe-l’oeil
Glossaire
Atlas des peuples et des lieux cités
Bibliographie
Notes
Index.
Un extrait de Casus belli
Guerre et feud
« Il faut détinir pour débuter, si l’on ne veut pas finir par buter’. »
Georges ELGOZY
Rien de plus simple, à première vue, que de définir la guerre : elle nous est si familière, elle marque l’histoire de nos sociétés depuis tant de millénaires qu’il semble n’y avoir aucun mystère ni aucune difficulté à savoir en quoi elle consiste. En réalité, il en va de la guerre comme d’autres phénomènes sociaux : la question n’est facile qu’à condition de ne pas se la poser sérieusement, et la prise en compte de sociétés radicalement différentes révèle les biais qui pèsent sur nos intuitions ».
Depuis quelques décennies que se sont multipliées les études sur la guerre émanant des disciplines les plus diverses, le sujet a donné lieu à une immense littérature sans qu’aucune définition s’impose de manière consensuelle. Cette question est évidemment cruciale : selon qu’elle sera large ou stricte, en préhistoire et dans les sociétés dépourvues d’État, on verra des « guerres » un peu partout ou nulle part. Ainsi que le souligne Bruno Boulestin dans un article fondamental dont on reprendra ici les principales conclusions’, définir correctement la guerre – comme tout autre phénomène social – suppose d’écarter les éléments qui l’enferment a priori dans une forme ou un type social donné. Dire ainsi, comme le font la plupart des dictionnaires, que la guerre est un conflit armé entre États, c’est écarter d’emblée la possibilité de guerres dans des sociétés non étatiques, sans même se donner la possibilité d’examiner si une telle restriction se justifie D’une manière générale, définir un fait social par la nature de l’individu ou du groupe qu’il implique constitue invariablement une grave faute de méthode – on aura l’occasion d’y revenir.
Pour commencer, il faut partir des constatations les plus banales. La première est que le terme de « guerre » est couramment employé dans des sens divers, depuis le plus étroit jusqu’au plus métaphorique. Malgré les efforts lexicaux du gouvernement russe, il ne fait guère de doute que l’« opération militaire spéciale » d’Ukraine constitue une authentique guerre : elle oppose deux camps armés qui s’affrontent en s’infligeant des pertes matérielles et humaines élevées. Si l’on parle, en revanche, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou de la « guerre contre la pauvreté » proclamée en son temps par un président des États-Unis, il ne fait là non plus pas de doute qu’on désigne une tout autre catégorie de faits. Tout comme la « guerre des nerfs », ou celle des « chefs », ces guerres-là ne le sont que par extension : elles diluent le sens du phénomène original – et c’est bien a raison pour laquelle elles appellent un adjectif ou un complément le nom, La guerre « tour cour », celle qui s entend au sens strict. es donc un état d’hostilité qui justifie le recours à des confrontations non seulement physiques, mais homicides : on n’imagine pas und guerre à fleurets mouchetés, dans laquelle il serait interdit d’ôter la vie; ce n’est pas pour rien que quand on repère de telles coutumes, on se sent obligé de préciser que ces guerres étant « rituelles » (ou quelque autre adjectif que ce soit), elles ne sont justement pas de « vraies » guerres.
Mais si toute guerre est un conflit homicide entre groupes, réciproquement, tout conflit homicide entre groupes est-il une guerre ? La réponse n est pas si évidente pour certaines situations qui subsistent dans nos sociétés, telles que les affrontements qui mettent aux prises des clans de trafiquants de drogue: quelle limite faut-il tracer entre des événements qui seront assimilés à de simples règlements de comptes et ce qui pourra être qualifié de « guerre des gangs » ? Dira-t-on qu’une telle guerre des gangs n’en est pas vraiment une ? Ce serait oublier que. dans certains pays. les gangs peuvent acquérir une puissance nilitaire face à laquelle l’État ne dispose que d’une supériorité touroelarive. Ce serait aussi = er surtout – oublier que, du noint de vu de ceux qui la vivent et qui la subissent, la « guerre des gangs », si illégale soit-elle, ne se distingue de manière évidente, ni par ses motivations ni par les moyens qu’elle emploie, de son homologue étatique et officiel. Les mêmes remarques valent pour les guerres internes : à partir de quelle limite des événements tels que ceux qui marquèrent par exemple la Nouvelle-Calédonie au printemps 2024 doivent-ils être considérés comme de simples émeutes ou comme un début de guerre civile?
Les choses se compliquent encore lorsque l’on prend en compte, de surcroît, une pratique disparue depuis longtemps de notre propre univers social mais que les anthropologues ont identifiée dans la plupart des sociétés sans État qu’ils ont étudiées : celle du feud…
…
2007 Le chimpanzé et la chasse « à la lance »
2012 Des lances à pointes de pierre dès 5 Ma
2018 Armes létales, archéologie expérimentale
2020 Des armes de jet il y a 300 000 ans
2024 Schöningen, plusieurs techniques pour le travail du bois …

Jean Guilaine et Jean Zammit
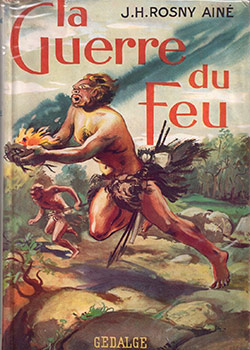
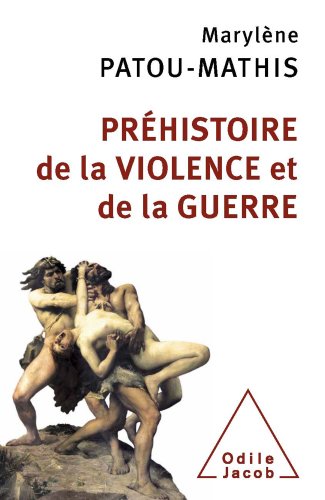
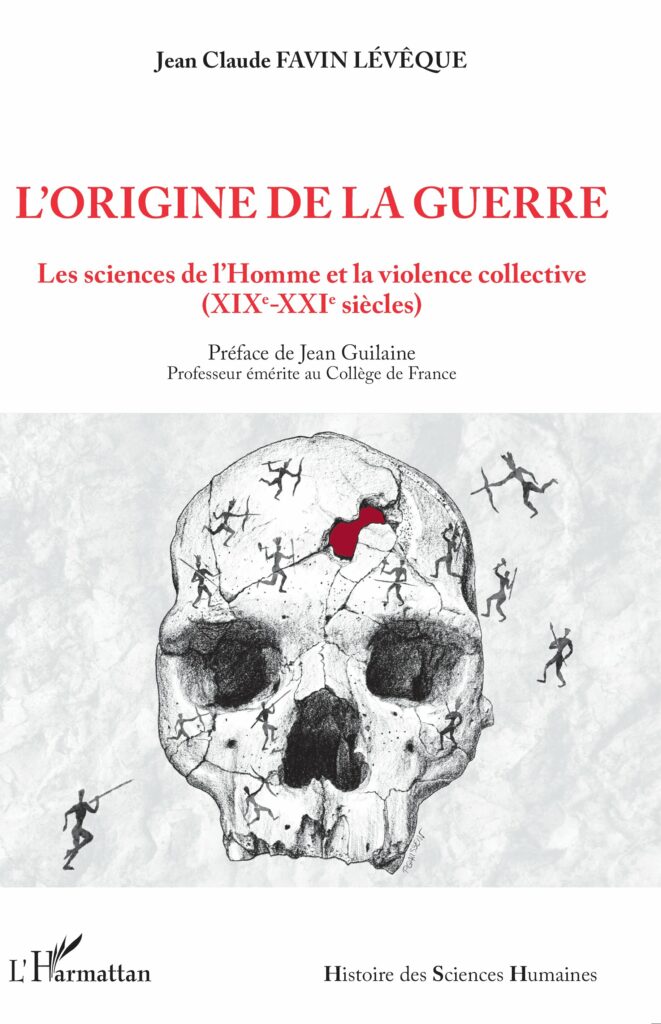
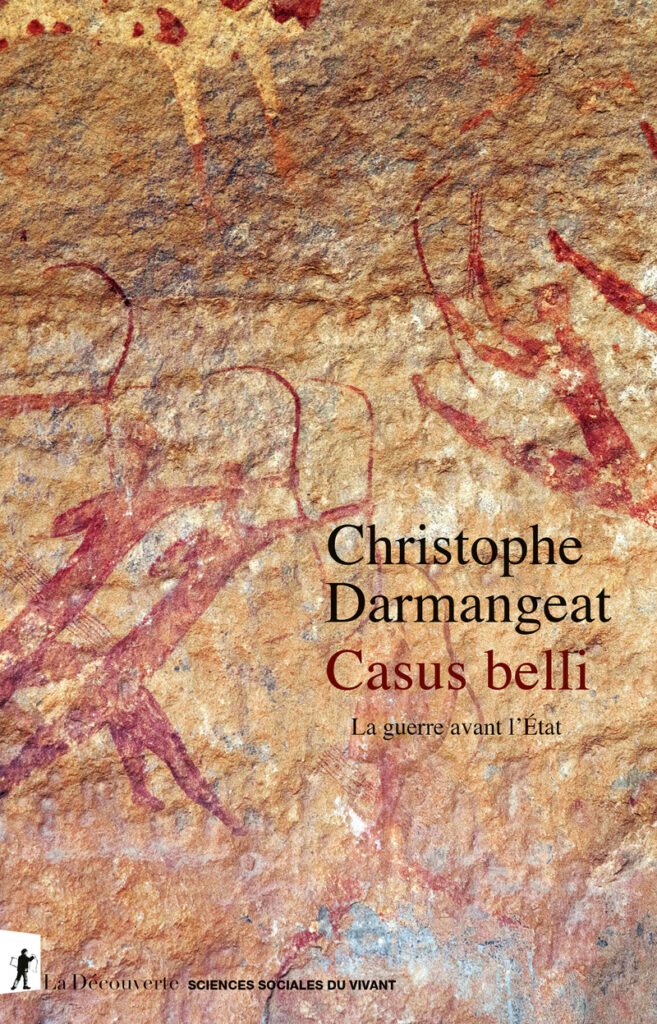
Christophe Darmengeat
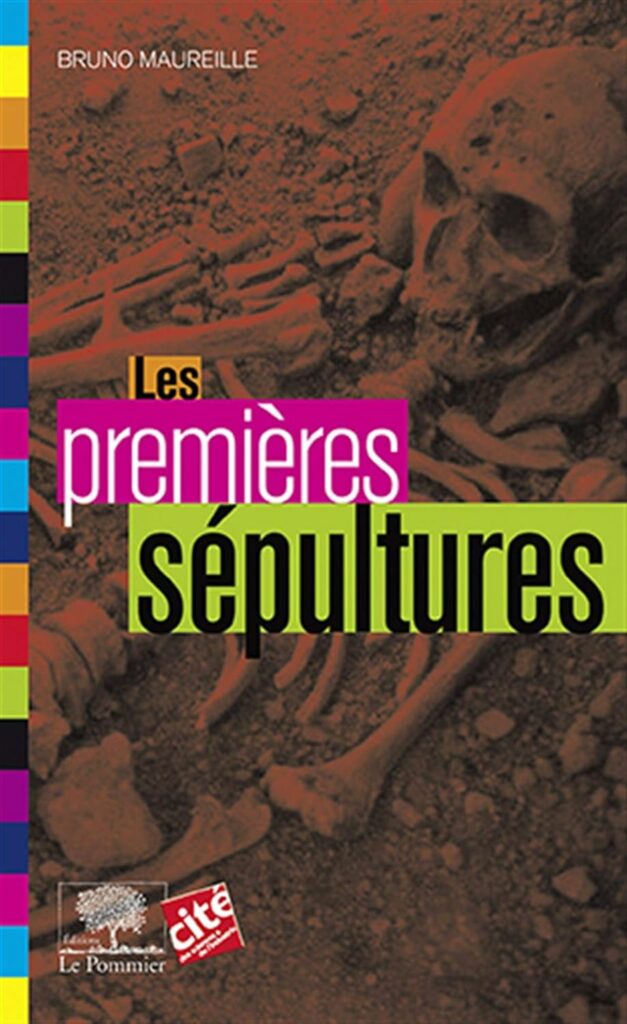
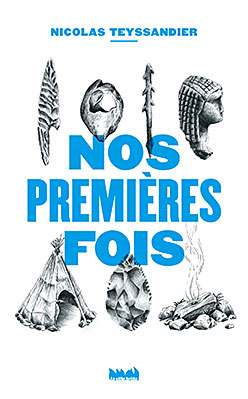

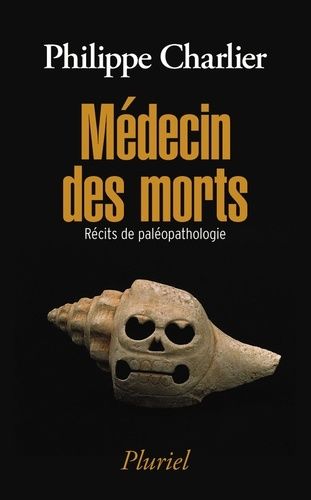
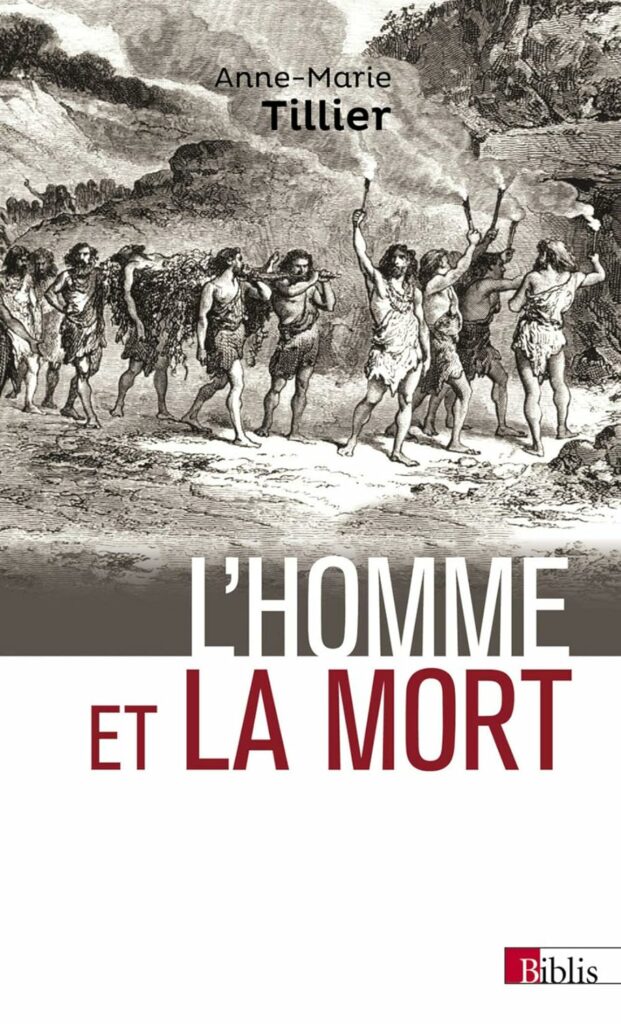
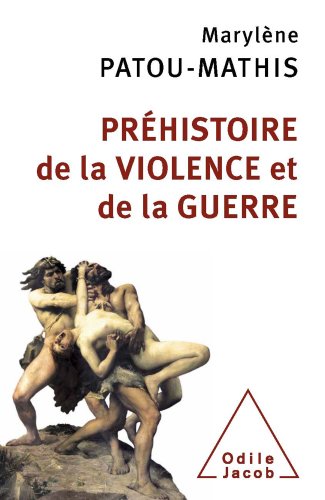
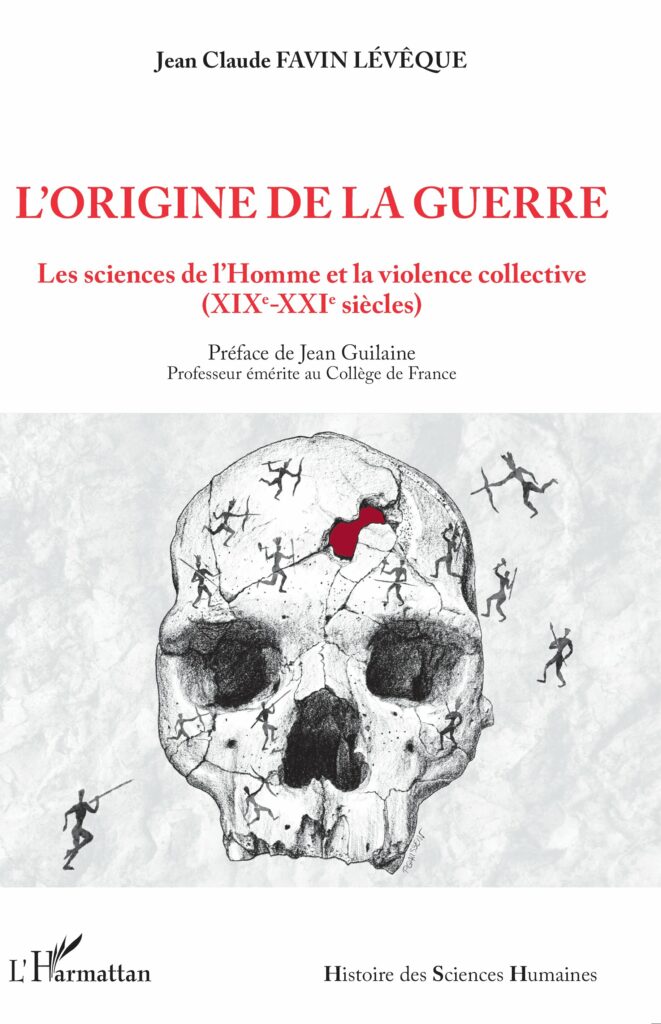
Les sciences de l’Homme et la violence collective (XIXe-XXIe siècles)
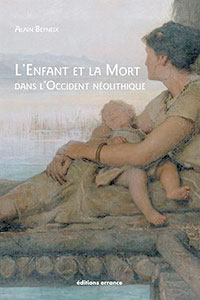
Alain Beynex
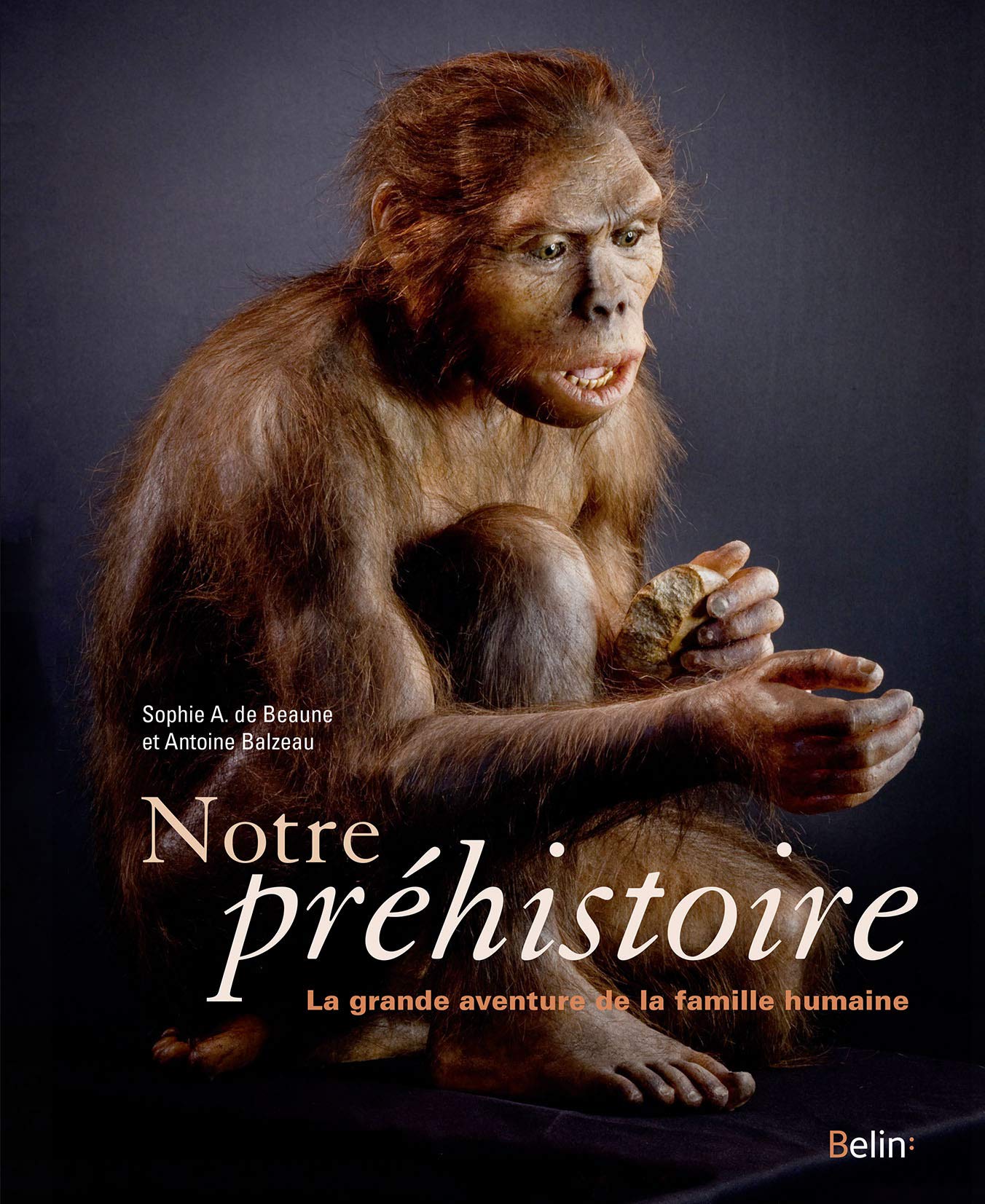
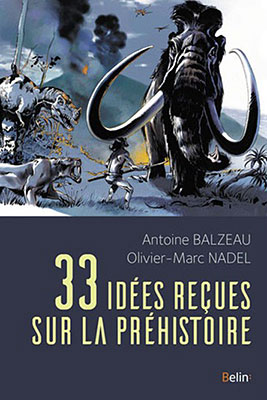
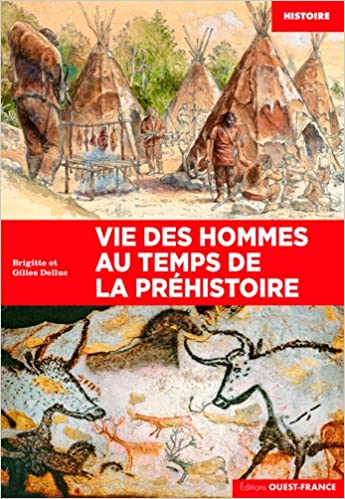
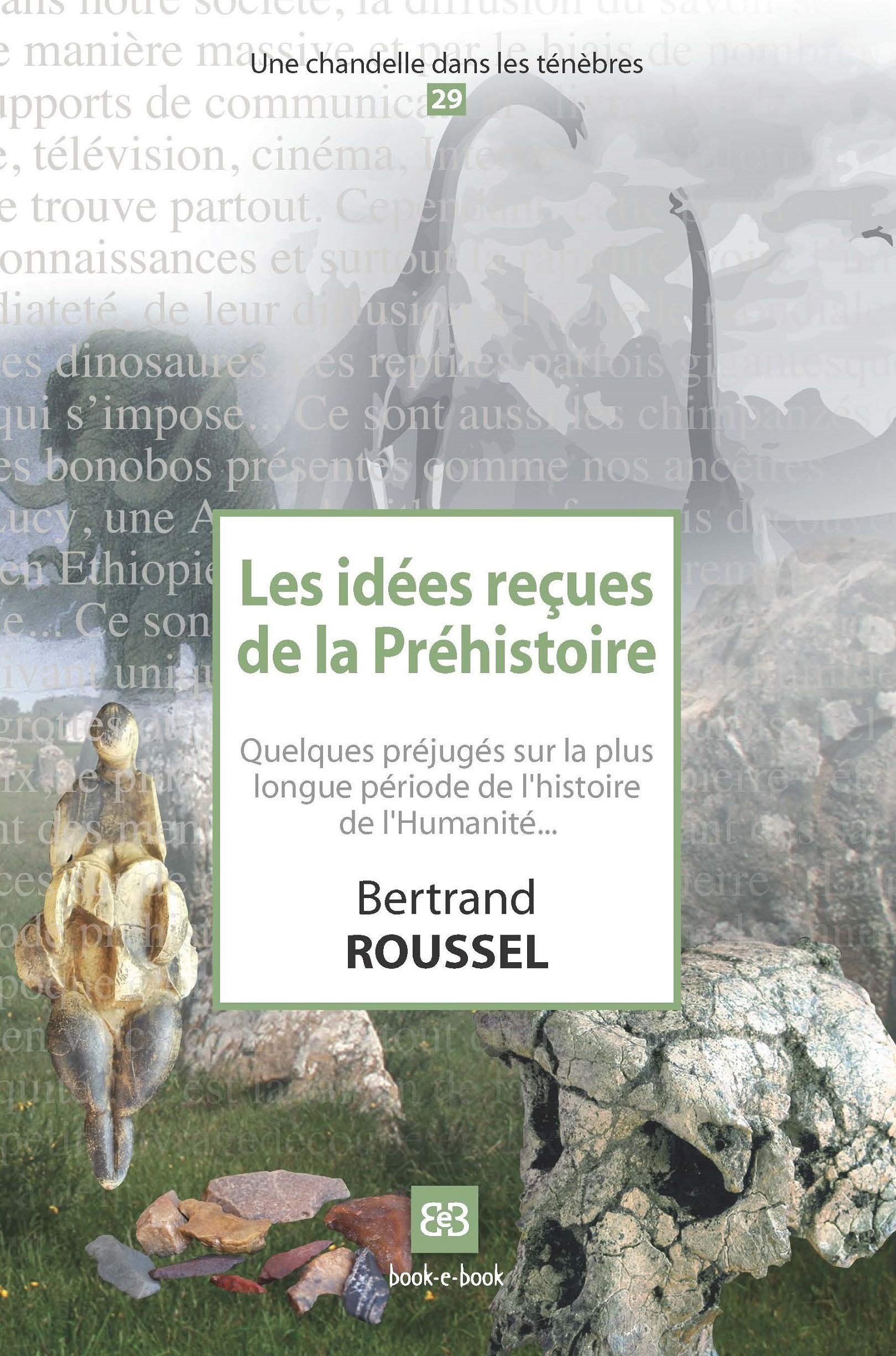
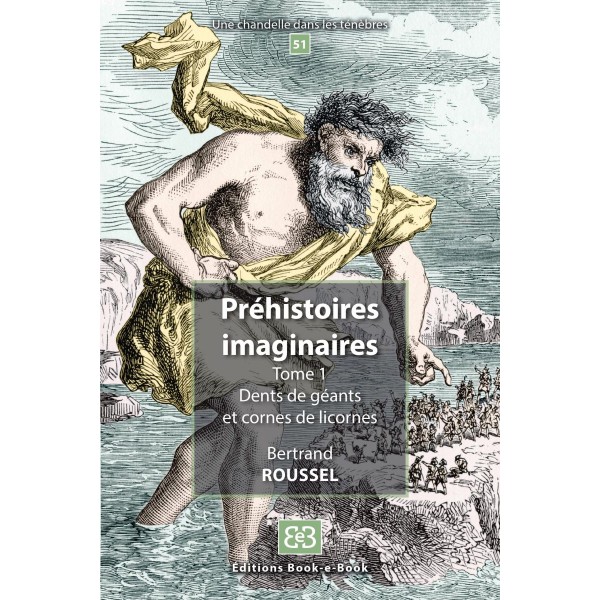
Bertrand Roussel